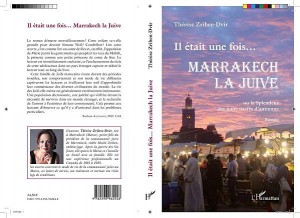
Il est des livres comme des êtres, il y a ceux que nous lisons et ceux qui vous lisent.
J’ai ouvert l’ouvrage de Thérèse Zrihen-Dvir comme on peut aller à un rendez-vous avec une amie très chère. Nous savons que nous passerons un agréable moment, que nous apprendrons l’un de l’autre et qu’en se quittant, c’est une page de nostalgie que nous ouvrirons. Mais ce fut bien plus. Dès les premières lignes l’écriture me happa dans un monde où se côtoyaient le coutumier et le magique, le quotidien et le sacré, l’ordinaire et le miraculeux. Un monde d’images familières et cependant étranges, de chaleur persistante avec des fulgurances d’acier, de mille bruits et de sons étouffés. Chaque page m’était un guide consciencieux, m’indiquant le chemin à suivre, dans ce labyrinthe des consciences et des corps en souffrance. Les âmes des mots se mettaient à vivre, prêtes à l’appel de l’esprit. Je suivis donc Fanny, la jeune femme abandonnée par Sol, qui allait donner vie à Marie, l’héroïne indomptable et fragile.
« Je voulais voir un homme marcher au-dessus de l’abîme. J’ai pensé en le regardant : si l’homme travaillait sur son âme autant que sur son corps, quels profonds abîmes ne pourrait-il franchir sur le fil de la vie » ( Baal chem tov )
Il est des livres comme des êtres, il y a ceux que nous lisons et ceux qui vous lisent.
J’ai ouvert l’ouvrage de Thérèse Zrihen-Dvir comme on peut aller à un rendez-vous avec une amie très chère. Nous savons que nous passerons un agréable moment, que nous apprendrons l’un de l’autre et qu’en se quittant, c’est une page de nostalgie que nous ouvrirons. Mais ce fut bien plus. Dès les premières lignes l’écriture me happa dans un monde où se côtoyaient le coutumier et le magique, le quotidien et le sacré, l’ordinaire et le miraculeux. Un monde d’images familières et cependant étranges, de chaleur persistante avec des fulgurances d’acier, de mille bruits et de sons étouffés. Chaque page m’était un guide consciencieux, m’indiquant le chemin à suivre, dans ce labyrinthe des consciences et des corps en souffrance. Les âmes des mots se mettaient à vivre, prêtes à l’appel de l’esprit. Je suivis donc Fanny, la jeune femme abandonnée par Sol, qui allait donner vie à Marie, l’héroïne indomptable et fragile.
Mais, d’une façon curieuse et pourtant évidente, les pièces du puzzle ingénieux allaient se mettre en place. Fanny, la jeune juive de Marrakech, ville berbère, océanique mais déjà saharienne, s’adossant au Haut Atlas pour mieux se projeter vers la « Mare Nostrum », nous renvoyait à une autre Fanny, de Marseille, que Marcel Pagnol fit aussi « fille-mère ».
Par un miracle, que seule la destinée peut accomplir, elle fut incarnée à l’écran par Henriette Burgart, dont le nom de scène, retenu par la postérité, était Orane Demazis composé à partir du nom de sa ville de naissance et d’une autre ville des environs d’Oran. Soudain la Méditerranée s’imposait en toile de fond. Elle sera la providence et distribuera les cartes. Sol, le fil conducteur, nous comble de bonheur. Sol comme la terre rouge du nord de l’Afrique, comme la monnaie romaine, comme la personnification du soleil, comme le cinquième degré de la gamme en musique. Ce don Juan, fils aussi de Séville, pour séduire les Belles, chantait-il alors la musique gnawa, chaâbi, andalouse ou berbère ?
Thérèse, par la puissance de l’étymologie des mots choisis, a habilement tissé sa toile et peut, à bon dessein, capturer notre inconscient volage. Un grand livre n’est-il pas une hypnose par surprise ? Thérèse dévoile ses thèmes comme des étapes initiatiques : Le Mellah de Marrakech ne peut que mener au départ des juifs malgré la résistance de Fanny, Paris ville lumière, n’évitera pas le kibboutz avec ses religieux, ses athées et ses diverses langues que l’on se doit de dépasser et d’unifier par un Oulpan dans un hébreu moderne. Et la guerre de Kippour n’était-elle pas en germe dans celle des « six jours » ?
Ghetto de fiel, ghetto de miel, ghetto haï, ghetto chéri, ghetto quitté pour mieux s’y replier …
Mais ce n’est pas qu’une histoire juive qui nous est contée. Marie nous attache par son caractère, sa beauté de princesse et cette volonté de vivre « fermement décidée à voir le jour ». Marie nous captive par son prénom universellement voué au culte, par ses colères et sa sensualité, par ses faiblesses et ses tourments, par sa droiture et ses contradictions, elle qui trouvera la vie en Israël « exigeante et ingrate » mais qui aimera « chaque parcelle de cette terre ».Elle qui abolira le temps et l’espace par la vertu de l’amour. Elle qui finira par admettre que dans ce « corridor » qu’est le cosmos, elle est née pour vivre et non pour se préparer à vivre. Elle qui retrouvera la sagesse des vieux juifs espagnols : « Ce que peut le temps, la raison le peut aussi ».
Comme toutes les histoires d’amour inscrites dans la grande Histoire de l’humanité existe entre Philippe et Marie un miracle semblable à celui de Tristan et Iseult, de Marius et Fanny, de Jivago et Lara …
Il y a du roman russe dans le livre de Thérèse. Pas seulement par le foisonnement des situations et des personnages, par le plaisir que l’on prend à écouter les mots nous parler, par l’entrelacement des vies intimes et du chaos des évènements extérieurs, non il y a aussi, il y a surtout cette adresse à l’humain, cette lucide désespérance qui faisait dire à Pasternak : « Songez-y, quel temps est le nôtre ! Et vous et moi vivons ces jours. Mais ce n’est qu’une fois dans l’éternité qu’arrivent ces histoires de fous! Songez que tout un peuple est à ciel ouvert … Il va , il vient sans se lasser, et parle et parle. Et ce ne sont pas les hommes seulement. Les étoiles et les arbres se sont réunis et bavardent … Ça a quelque chose de biblique, n’est-ce pas ? ».
Quelque chose de tragique et douloureux là où « Diaspora » et « Israël » devinrent deux concepts conditionnant les attitudes mentales de la société israélienne. « Israël » symbolisant alors le neuf, le droit, le sain, et « Diaspora » le vieux, le courbé, le malsain. Ceux qui arrivaient étaient d’une autre espèce comme dans la nouvelle de Yehudit Hendel : « C’est une autre espèce de gens, Leizer . Ils sont simples, oui, voilà c’est ça, c’est un autre genre. ».
Camus, l’algérien nous rappelle que nous sommes toujours « l’étranger » pour quelqu’un et rendu étranger à nous même par la roue impitoyable de l’Histoire. C’est dans la ligne du prophète de Mondovi que Thérèse trace son sillon humaniste.
« La Méditerranée, mère d’humanité » pour réconcilier les enfants d’Abraham … Fraîchement promu lauréat du Prix Nobel de Littérature, Albert Camus déclarait : « Je suis simplement reconnaissant au comité Nobel d’avoir voulu distinguer un écrivain français d’Algérie. Je n’ai jamais rien écrit qui ne se rattache, de près ou de loin, à la terre où je suis né. C’est à elle, et à son malheur, que vont toutes mes pensées ».
Thérèse Zrihen-Dvir, grâce à ses héros de papier, retourne sans cesse à ce Maroc où si ses habitants ont adopté maintes religions, ils y ont introduit des éléments d’origine païennes, tels que le culte des sources, des grottes, des arbres et des génies :« Traditions et convictions se cramponnent au réel, en dépit du progrès. Dans leur formes les plus archaïques, ces survivances paraissent souvent ingénues ou désuètes, mais leur perpétuation produit l’illusion de vivre dans un monde immuable ».
Alors Marie échappe-t-elle à sa créatrice pour nous glisser la merveilleuse chanson, si terriblement prémonitoire, de la petite juive Judy Garland, Somewhere over the rainbow, qui déjà rêvait d’Eretz …
Rappelez-vous : « Quelque part, au-delà de l’arc-en-ciel, bien plus haut, il y a une contrée, dont j’ai entendu parler une fois dans une berceuse. Quelque part, au-delà des arc-en-ciel, les ciels sont bleus, et les rêves que tu oses rêver deviennent vraiment réalité. Un jour je ferai un souhait en regardant une étoile et je me réveillerai à l’endroit où les nuages sont loin derrière moi, où les ennuis fondent telles des gouttes de citron, bien au dessus des cheminées … ».
Thérèse et Marie, Marie et Thérèse ont emporté à Tel Aviv toutes les beautés de l’exil : les palmes, le Ksar, la Koutoubia, les Djebilet, les remparts de Bab Doukkala et les tombeaux saadiens.
Toutes deux, comme Dorothy du Kansas, après la Terre promise, ses merveilles et ses douleurs, ne rêvent-elles pas en secret, de frapper leurs souliers rouges, trois fois, et de dire en fermant les yeux : « Je retourne auprès de ceux que j’aime ». L’enfance est un voyage oublié.
Le livre refermé, nous les laissons à leur mystère mais pour nous émouvoir autant, elles ont bien dû, l’une et l’autre devenues indissociables à nos yeux, mettre un peu d’elles-mêmes.
De leur relative et pardonnable impudeur nous les en remercions car nos émotions partagées eurent été solitaires. Nous n’aurions alors vu que des fantômes comme la nuit s’agrandit quand les rêves se fiancent.
Jean-Marc DESANTI